 INTRODUCTION INTRODUCTION
Aujourd’hui les questions
d’énergies revêtent une importance cruciale pour
l’environnement. En effet, les problèmes liés à
l’augmentation de l’effet de serre et à la
pollution atmosphérique deviennent de plus en plus
préoccupants.
C’est pourquoi de
nouveaux procédés de production d’énergie ont été
développés dans le but de trouver une alternative.Les énergies renouvelables sont
issues de phénomènes naturels, réguliers ou
constants.La
France et l’Europe se sont mutuellement engagées à
réduire leurs émissions de CO² et à développer des énergies
renouvelables. La France a décidé de se fixer comme objectif, à
travers le cadre d’une directive européenne, en 2001,
d’obtenir 21% de sa consommation d’électricité
grâce ou à partir d’énergies renouvelables pour 2010. Cet
objectif est conforté dans le cadre du Grenelle de
l’Environnement dont une des recommandations est
l’augmentation de la production d’énergies
renouvelables.
Les énergies renouvelables
contribuent de nos jours à satisfaire un peu plus de 12% de
notre consommation finale d’énergie. On peut alors dire
que grâce au bois et à l’hydraulique, la France peut se
placer en premier producteur européen d’énergies
renouvelables.Le
soleil peut être généralement à l’origine de la création
de nombreuses énergies renouvelables. Le vent peut aussi être
exploité en tant qu’énergie. Le caractère renouvelable
d’une énergie dépend de la vitesse à laquelle la source
se régénère. Mais elle dépend également de la vitesse à
laquelle elle est consommée. Ces énergies préservent
l’environnement, elles ne mettent pas en danger
l’Homme. Celles-ci produisent très peu de déchets et
engendrent très peu d’émissions polluantes, à la
différence du nucléaire. Ce sont des énergies propres.
Actuellement il faut savoir que
les énergies renouvelables occupent tout de même une place
limitée. On peut
alors se demander comment l’Etat français gère
l’après pétrole ? Pour cela nous allons faire un état des
lieux, puis évoquer les différentes énergies renouvelables
ainsi que leurs avantages et leurs limites, et enfin parler de
l’avenir …
 Partie 1
: Etat des lieux Partie 1
: Etat des lieux
1) Conséquences des crises pétrolières
A/ Choc pétrolier de 1973
Le 6 octobre 1973, Israël fête un jour très important de
leur calendrier, Yom Kippour. Les Égyptiens attaquent Israël
afin de réparer l'humiliation subie lors de la guerre de Six
Jours en juin 1967 et de récupérer les terres perdues.
Il en résulte, du coté
des pays arabes, une augmentation de 70% du prix du baril de
pétrole brut, une diminution de 5% de la production de pétrole
et un embargo du pétrole en direction des Etats-Unis et de
l'Europe. Le baril de pétrole est passé de 3$ à 12$ en un
an.
Après ce choc pétrolier, les
pays occidentaux ne sont désormais plus en position de force,
car ils ne peuvent pas se passer de l'or noir venu
d'Orient.Au niveau économique, la très forte
augmentation du prix du pétrole entraîne, en France, une baisse
de 15% de la production industrielle, et une très forte
inflation conduisant à une baisse de l'investissement et une
hausse considérable du chômage (1million de chômeurs en 1975).
Cela s'appelle la stagflation.
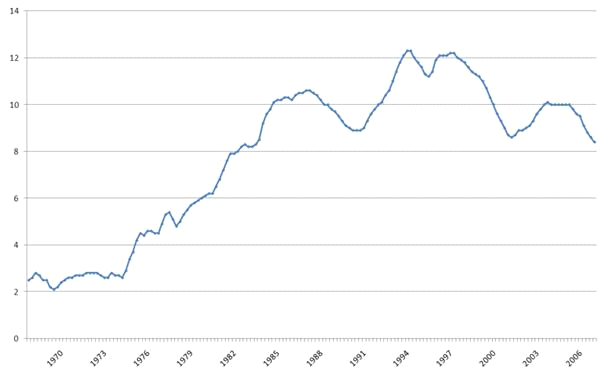
Document 1:
Évolution du chômage sur ces trente dernières années
Cette crise pétrolière marque définitivement la fin des
Trente-Glorieuses, définissant ces trois dernières décennies
marquées par une croissance ininterrompue et des
bouleversements majeurs que la France et l'Europe de l'Ouest
avaient connus depuis la fin de la Seconde Guerre
mondiale.Les conséquences
ont été telles que les pays, se rendant compte du danger d'une
pénurie de pétrole, ont lancé les premières mesures contre le
gaspillage du pétrole. Les pays consommateurs de pétrole
tentent également de remplacer l'or noir arabe par le gaz
soviétique.
La France de son côté, lance un tout
nouveau programme d'énergie nucléaire en 1974. Malgré cela, la
croissance ne cesse de ralentir et le chômage
d'augmenter.
B/ Choc pétrolier de 1979
En 1979, la chute du Shah, et le retrait du
pétrole iranien, entraîne le deuxième choc pétrolier. Ce double
choc, en moins de dix ans, modifie radicalement
l’économie de la planète.Le prix du baril de pétrole a
été multiplié par 2,7 entre 1978 et 1981. Après cette seconde
crise pétrolière les pays se rendent compte qu'ils ont besoin
d'une gestion prévoyante des ressources énergétiques qu'ils
consomment, et d'une diversification progressive des sources
d'énergies.
Ce
double choc est finalement assez vite amorti par le
fonctionnement du marché et les mesures d’adaptation
prises dans les pays consommateurs : ceux-ci tentent de baisser
alors leur dépendance énergétique.
Le défi est maintenant de
maîtriser les technologies d'exploitation de nouvelles énergies
et de mise en valeur de nouveaux gisements
pétroliers.
2) Ressources énergétiques présentes en
France
La France utilise principalement des combustibles fossiles
produisant beaucoup d'énergies pour répondre aux besoins
énergétiques du pays. Les combustibles fossiles sont des
matières premières venant de roches issues de la fossilisation
d'êtres-vivants, c'est-à-dire, le pétrole, le charbon, ou le
gaz naturel. Malheureusement la France est très dépendante de
ces importations.
En 2008 l'importation de pétrole a été de 83 millions de
tonnes, celle de charbon de 14,2Mtep et celle de gaz naturel de
40Mtep.Mais la France
développe également un programme d'énergie nucléaire, couvrant
en 2004, 79% de la production française d'électricité. Enfin,
la France utilise des énergies renouvelables, atteignant en
2008 19Mtep soit près de 14% de la production d'énergie
française.
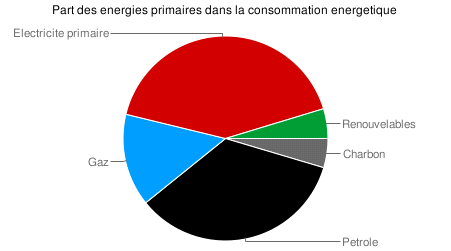
Document 2
:La part des énergies primaires
dans la consommation énergétique
A/ Energies fossiles
Pétrole
Tout d'abord, de
nombreuses incertitudes existent à propos des réserves
pétrolières mondiales, mais certaines évaluations s'accordent à
dire qu'il y a environ 1 000 milliards de barils de pétrole
brut dans les gisements pétroliers. Au rythme de la
consommation mondiale, il reste 42 ans de réserves de pétrole
(la France quant à elle a utilisé à peu près 276 millions de
tonnes de pétrole en 2008).
Ce problème de pénurie
progressive du pétrole pose un gros problème à la France qui
utilisait le pétrole pour un tiers de sa consommation d'énergie
en 2005, notamment pour le transport qui représente à lui seul
53% de la consommation totale. La France a exploité, en 2008,
1 million de tonnes de pétrole contre 50000 tonnes en 1939,
pourtant, cela ne représente que 1,5% de la consommation
annuelle française soit 18 ans de réserves, si on continue au
même rythme de consommation. La production
française de pétrole étant donc très limitée, les importations
de pétrole restent nécessaires, en 2006, la France a importé 7
millions de tonnes de pétrole.

Document 3 :L'évolution des importations de
pétrole en France
Charbon
Le charbon fut l'une des
énergies les plus importantes du XXe siècle, en 2003 la
consommation française de charbon était de 22 millions de
tonnes, dont 1,8 million de tonnes produites en France, et 18,4
millions de tonnes importées. Le charbon est principalement
utilisé pour la production d'électricité (45%), mais aussi pour
la sidérurgie (32%) et pour le secteur tertiaire
(23%).Depuis 1947, la production de
charbon connaît une constante diminution. En effet, elle passe
de 47 millions de tonnes en 1947 à 2 millions de tonnes en
2003.
Malheureusement,
selon la loi n°2004-105 du 3 février 2004, les Charbonnages de
France (acteur majeur de l'activité minière en France) se
doivent de cesser toute activité industrielle, de réhabiliter
les sites miniers, de s'occuper du traitement et du transfert
de ses archives, de poursuivre son action de développement sur
les zones où il y a eu de l'activité minière et enfin d'assurer
le dépôt des dossiers d'arrêt des travaux. Cela mène à la fin
de l'ère minière.
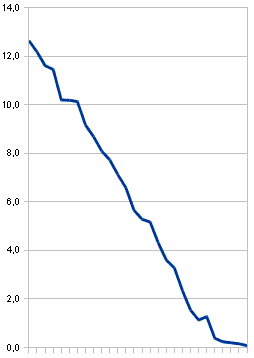
Document 4 :
Consommation de charbon en France de 1981 à 2008 (en millions
de tonnes équivalent pétrole)
Gaz naturel
Le gaz
naturel est principalement utilisé dans le domaine domestique
(chauffage), mais également dans le domaine industriel. Alors
qu'en 1970, la consommation nationale de gaz naturel était
assurée à 33% par la production nationale, en 2007,
l'augmentation de la demande et la diminution des ressources
obligent la France à importée 98% des besoins de gaz naturel.
En 2008, 40Mtep de gaz naturel ont été importés principalement
de Norvège et des Pays-Bas.
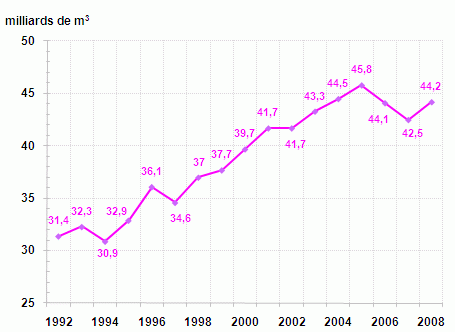
Document 5 : Évolution de la consommation de
gaz naturel en
France.
De plus, les réserves françaises
sont très limitées car elles ne contiennent que 6 milliards de
mètres cube de gaz naturel, seulement de quoi subsister 5 à 6
ans en plus des importations.
B/ Energies nucléaires
Le
programme nucléaire de la France débute en 1946, seulement deux
ans après, un gisement d'uranium très important est découvert à
« La Courzille ». Mais en 2001, la dernière mine d'uranium
française est fermée, désormais seules les importations
permettent de subvenir aux besoins en uranium. Selon l'OCDE,
Organisation de Coopération et de Développement Économique, les
ressources d'uranium inutilisées du sol français s'élèvent à 11
740 tonnes.
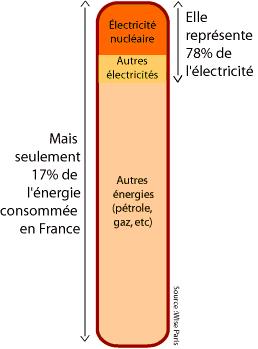
Document 6 : La part des énergies nucléaires
en fonction des autres
énergies
Le
nucléaire représente 17% de l'énergie consommée en France, et
l'électricité fabriquée grâce au nucléaire représente 78% de la
consommation. L'usage du nucléaire présente trois avantages.
Tout d'abord, il permet à la France d'être le pays de l'OCDE le
moins émetteurs de CO². Il contribue à notre sécurité
d'approvisionnement en permettant à notre pays d'assurer la
moitié de ses besoins. Enfin, il permet de disposer d'une
électricité très compétitive par rapport à la production issue
de centrales thermiques à combustible
fossile.
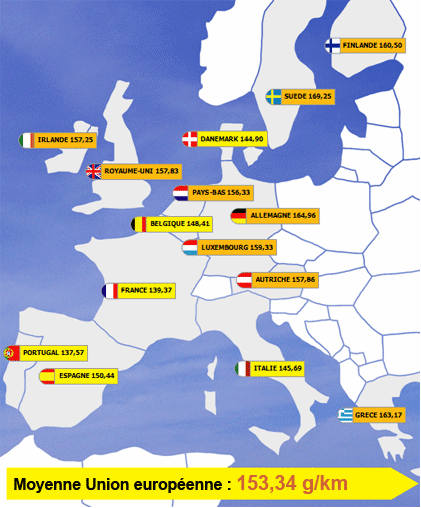
Document 7:Carte des émissions moyennes de
CO² en Europe (en
g/km)
C/ Energies renouvelables
Au vu des très grands problèmes
que posent les énergies fossiles et le nucléaire pour l'avenir
de la planète, nous devons songer à les remplacer par des
énergies propres et
renouvelables.
L’expression
“énergie renouvelable” est apparue dans les années
70. Elle désigne des énergies dites de flux, par opposition aux
énergies fossiles. Autrement dit, les énergies renouvelables ne
s’épuisent pas : l’Homme transforme l’énergie
produite par la nature en énergie directement utilisable
(électricité, chaleur, combustible). Elles sont actuellement au
nombre de six : l’hydraulique, la biomasse,
l’éolien, la géothermie, le solaire et l’énergie
des mers. Elles sont inépuisables, mais leur développement se
heurte toutefois à certains
facteurs.La prise de conscience
collective du réchauffement climatique a propulsé les énergies
renouvelables sur le devant de la
scène.
Le marché des énergies
renouvelables affiche des taux de croissance très positifs,
supérieurs à 30% par an. Mais la France, qui n'a engagé une
politique volontariste que depuis 2005, affiche un retard
important.La
France utilise principalement deux énergies renouvelables,
l'hydraulique et l'énergie liée au bois. La consommation
d'énergies renouvelables représente 6,03% de la consommation
d'énergies totales, et la France a pour objectif, d'atteindre
10% de consommation d'énergies
renouvelables.
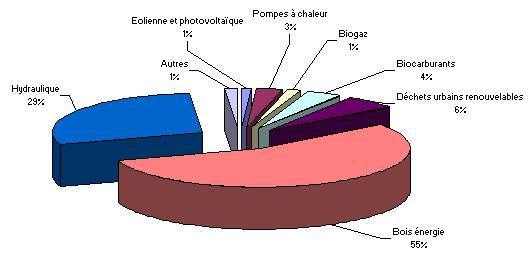
Document 8 : la
répartition de la consommation des énergies renouvelables en
France (2006)
La rentabilité des énergies
renouvelables est encore faible par rapport aux énergies
traditionnelles, car si elles sont abondantes, il faut encore
pouvoir les capter, les collecter, les concentrer et les
transporter. Le résultat est que les investissements sont très
élevés et les coûts restent souvent beaucoup plus importants
que pour les énergies fossiles. Les politiques publiques de
soutien sont donc indispensables pour voir fructifier
l'utilisation des énergies renouvelables.
 Partie 2
: Les énergies renouvelables Partie 2
: Les énergies renouvelables
Les énergies renouvelables
étudiées, peuvent se classer selon deux groupes distincts : il
y a les énergies renouvelables électriques et les énergies
renouvelables thermiques. Dans les énergies renouvelables
électriques, nous pouvons identifier l’hydroélectricité,
l’éolien, le solaire photovoltaïque. Dans les énergies
renouvelables thermiques nous pouvons identifier le
bois-énergie ou biomasse solide, les biocarburants, les pompes
à chaleur (PAC), la géothermie, et le solaire
thermique.
1) Dans les énergies renouvelables
électriques:
A/ L'hydraulique

L’hydraulique est
l’une des premières énergies domestiquées par
l’homme (moulins au fil de l’eau, bateau à
aubes…). L’énergie hydraulique tire son origine
dans des phénomènes météorologiques. Ces phénomènes
météorologiques prélèvent de l’eau principalement dans
les océans, s’écoulent vers les rivières et en libèrent
une partie sur les continents à des altitudes variables.
L’hydroélectricité, c’est-à-dire la production
d’électricité à partir de la simple force de l’eau,
a fait son apparition au milieu du XIXème siècle. Son principe
est de capter l’eau et la forcer à entraîner une turbine
reliée à une génératrice. Pour les faibles dénivellations, une
petite digue oriente une fraction du débit vers les turbines.
Pour les grandes dénivellations, des conduites suivent la pente
de la montagne pour amener l’eau vers les turbines. En
fonction du débit et de la vitesse de l’eau, la turbine
sera différente. Pour les faibles hauteurs d’eau avec des
débits importants, on fera appel à des turbines à axe vertical.
Tandis que pour les chutes de grande hauteur et de faible
débit, on fera appel à des turbines à axe
horizontal.
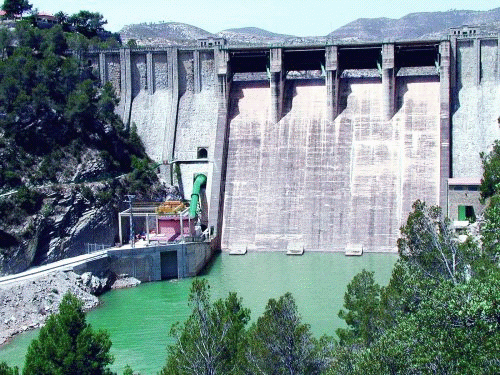
Document
9 :La grande
hydraulique
La France reste l’un des
pays les plus équipés, avec environ plus de 1730 centrales
représentant près de 2060 MW, pour une production de 7 à 7,5
TWh/an, soit 1,5 % de la production électrique nationale. Ces
centrales sont souvent exploitées, soit par des compagnies
d’électricité, soit par des producteurs
indépendants.
Il existe deux types de
centrales hydrauliques, la grande centrale et la petite
centrale. Cette dernière est souvent construite au fil de
l’eau. Toutes les petites centrales sont maintenant
conçues pour respecter la vie des cours d’eau et la
plupart des bâtiments ont fait l’objet de travaux
d’insertion dans le paysage. La petite hydraulique
dispose d’un avantage étant donné qu’elle est
ouverte à tout le monde, il suffit de disposer d’une
rivière à proximité avec un débit suffisant ou de pouvoir
capter l’eau d’une source ou d’un torrent
situé en amont. Mais tout d’abord cette installation sera
soumise à une autorisation préfectorale spécifique, le droit
d’eau étant obligatoire et indispensable pour entamer les
autres démarches. De plus son coût d’installation dépend
bien entendu de sa taille, de son type et de son accessibilité.
Les coûts s’élèvent à peu près entre 1200 et 3000 euro
pour la petite hydraulique. Sachant que l’investissement
s’amortit sur une période relativement longue, de dix à
vingt ans sans aide publique, pour la grande
hydraulique

Document
10 : La petite
hydraulique
L’électricité produite
par cette centrale, si celle-ci est en site isolé non reliée au
réseau électrique, le courant sera alors consommé sur place.
Tandis que dans le cas contraire, les kilowattheures seront
alors vendus à la compagnie d’électricité.
Mais divers
obstacles freinent encore le développement des petites
centrales comme la complexité de la réglementation, le coût de
raccordementau
réseau.
En moyenne depuis trente ans,
les centrales de plus de 10 MW fournissent 90 % de la
production d’électricité hydraulique. La production des
DOM représente en moyenne 1% à 2% de la production nationale.
Les principaux sites métropolitains convenant aux grandes
centrales sont déjà exploités (Alpes, Corse, Pyrénées et
Centre) et le nombre de sites qui pourraient être équipés de
petites centrales est limité. En revanche les DOM offrent un
potentiel important de développement pour la grande
et la petite hydraulique.
Ils existent aussi
d’autres énergies hydrauliques, l’énergie des
vagues qui utilise la puissance du mouvement des vagues,
l’énergie marée motrice issue du mouvement de l’eau
créé par les marées, l’énergie hydrolienne utilisant les
courants sous marins, l’énergie thermique des mers
produite en exploitant la différence de température entre les
eaux superficielles et les eaux profondes et l’énergie
osmotique, diffusion ionique provoquée par l’arrivée
d’eau douce dans l’eau salée de la mer est
également source d’énergie.
L’usine de la Rance, est
la seule usine en France capable de convertir en énergie
électrique l’énergie potentielle des
marées.

Document 12 :
L’évolution de la
production électrique d’énergie renouvelable, en TWh,
hydroélectricité comprise depuis
1970.
Ce graphique met en évidence la
prépondérance de l’hydroélectricité au sein des sources
renouvelables pour la production d’électricité.
B/ L'énergie éolienne
L’énergie éolienne est la
principale cause des phénomènes météorologiques. Ces derniers
se caractérisent notamment par des déplacements de masses
d’air à l’intérieur de l’atmosphère.
L’énergie mécanique de ces déplacements d’air est à
la base de l’énergie éolienne. Pour commencer
l’énergie éolienne a tout d’abord été utilisée par
les hommes de l’Antiquité : bateaux à voile pour les
conquêtes et le commerce, moulins à vent pour la meunerie,
l’irrigation … Mais c’est notamment au cours
de ces dernières décennies que l’énergie éolienne a
suscité un réel intérêt pour notamment de nombreuses questions
d’environnement. Il faut savoir qu’avec les
éoliennes, comme avec l’hydraulique, on produit des
kilowattheures propres et renouvelables.

Document
13 :Des
éoliennes
Une éolienne est constituée
d’un rotor à 2 ou 3 pales, d’un système de
transmission mécanique direct ou multiplicateur et de circuits
de gestion du courant. L’ensemble se trouve dans la
nacelle posée sur le mât, ou la tour de l’éolienne. Le
vent fait tourner les pales qui entrainent le générateur
électrique. Avec l’augmentation du prix du pétrole et du
gaz, le coût de l’électricité devient
compétitif.

Document
14 :Des éoliennes
Aujourd’hui les éoliennes
produisent entre 1,5 et 3 MW. Une machine de 2 MW a un rotor de
70 à 90 m de diamètre et la nacelle est perchée sur un mât de
60 à 100 m de hauteur. La production d’un parc dépend de
la quantité de vent du site. Comme l’énergie hydraulique,
l’éolienne est elle aussi soumise à des règles strictes
d’installation, permettant ainsi de concilier le
développement de l’énergie éolienne et la protection du
paysage et de l’environnement. Nous ne pouvons pas
installer une éolienne n’importe où, il faut respecter
les lois mises en place de janvier 2003 et de juillet 2005. Ces
lois exigent un permis de construire, une étude d’impact
et une enquête publique quand la hauteur du mât des éoliennes
dépasse 50m. Une éolienne ne peut se trouver près des
habitations ayant une ligne électrique proche. Si un
particulier décide d’installer une éolienne il la
financera alors lui-même et optera pour une à faible puissance.
L’éolien off-shore a un
avenir très prometteur. Nous disposons d’espace pour
installer des éoliennes puissantes et en grand nombres ; un
parc off-shore, pouvant rassembler des centaines
d’éoliennes. L’un des parcs les plus connus reste
celui de Horns Rev au Danemark avec 91 turbines générant 209 MW
sur une superficie de 35 kilomètres
carrés.
En Europe, le parc éolien
off-shore mondial était de 900 MW en 2006. Quant à la France,
elle dispose d’un potentiel éolien off-shore, qui
pourrait produire en 2020, 10% de sa consommation électrique
totale. Le coût de l’éolien off-shore est élevé, 1,6
millions d’euros le MW en mer. La France ne dispose pas
de grand parc éolien off-shore, cependant certaines sociétés
ont des projets en cours, notamment au large du Calvados pour
2013, au large de Saint-Brieuc. Pour 2011, le projet au large
de Veulettes-sur-Mer est le plus avancé en
France.
Unités : puissance en MW, production en
GWh
L’éolienne,
parmi les énergies renouvelables, est celle qui se développe le
plus rapidement en France. C’est en 1996 que les pouvoirs
publics ont contribué à l’émergence d’une industrie
éolienne en France. Profitant des avancées technologiques
réalisées ces dernières années, les nombreux projets en cours
développent des puissances de plus en plus importantes et
concernent désormais l’ensemble du territoire français
ainsi que l’éolien en mer
(off-shore).
C/ L'énergie photovoltaïque
L’énergie photovoltaïque
se base sur l’effet photoélectrique pour créer un courant
électrique continu à partir d’un rayonnement
électromagnétique. Cette source de lumière peut être naturelle
ou bien artificielle. L’énergie solaire photovoltaïque, à
distinguer de l’énergie solaire thermique, provient de la
conversion de la lumière du soleil en électricité. La
conversion directe du rayonnement solaire en production
électrique est réalisée grâce à des capteurs photovoltaïques,
qui transforment l’énergie des photons de la lumière en
un courant électrique continu recueilli dans le matériau
semi-conducteur exposé au rayonnement solaire.

Document
16 :Installation photovoltaïque
Les plus petits modules
photovoltaïques peuvent alimenter des montres, des
calculatrices ou encore des parcmètres ou des bornes
d’appel d’urgence sur autoroute. Mais des systèmes
un peu plus puissants peuvent fournir l’électricité pour
des sites isolés ou être reliés à un réseau de distribution
électrique, intégrés dans un bâtiment ou non. Pour chaque cas
de figure, l’équipement sera différent. Mais en revanche
l’utilisation en site isolé demande de pouvoir stocker le
courant pour une utilisation la nuit ou par mauvais temps. Les
modules produisent du courant continu, qu’ils
transforment en courant alternatif pour l’adapter à la
plupart des appareils électriques.
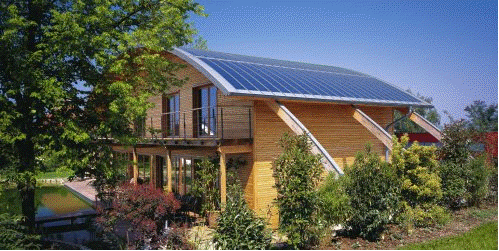
Document
17 :Installation photovoltaïque
Les premières installations
reliées au réseau étaient tout simplement équipées d’un
compteur unique, de type électromécanique, qui tournait à
l’envers en mode de production, et donc retranchait les
kilowattheures solaires produits. A présent la législation
française exige la présence de deux compteurs distincts :
l’un pour compter la consommation et l’autre, la
production. Mais aujourd’hui la part
du photovoltaïque dans la production totale d’électricité
est minime.
Le
solaire photovoltaïque, principalement réservé aux sites
isolés, bénéficie d’une croissance élevée depuis les
années 2000, avec le développement du photovoltaïque relié au
réseau, notamment dans les DOM.
2) Dans les énergies renouvelables
thermiques
A/ La biomasse solide ou le bois-énergie
La biomasse solide représente
les matériaux d’origine biologique qui peuvent être
employés comme combustible pour la production de chaleur ou
d’électricité. La biomasse est un combustible provenant
d’origines très variées. Le combustible provient tout
d’abord de la forêt, avec le traitement des rémanents, du
bois d’éclaircie ou d’élagage. Mais aussi toutes
les plantations non forestières peuvent convenir, comme les
parcs, les jardins, les bords de routes et les haies bocagères
fournissant du combustible. La biomasse solide s’utilise
nécessairement pour l’usage domestique des particuliers :
les cheminées, les cuisinières, les chaudières à bûches, à
granulés ou les chaudières automatiques. La biomasse peut aussi
s’adresser aux entreprises : ce sont essentiellement les
acteurs des filières de la forêt, de l’agriculture et des
déchets qui se lancent pour valoriser des sous-produits. La
biomasse solide se prête à la production de chaleur pour le
chauffage, la production de vapeur pour des procédés
industriels, le séchage… Il est aussi possible de
produire de l’électricité, ensuite revendue sur le
réseau. Toutefois, il faut savoir que la production
d’électricité seule à partir de biomasse constitue un
rendement plutôt faible.
De plus, durant sa croissance,
la biomasse consomme une grande quantité de dioxyde de carbone,
pour ensuite le libérer dans l’air lors de la
décomposition ou de la combustion du bois. La biomasse absorbe
le gaz. Ce qui provoque un équilibre et l’impact est donc
neutre sur l’effet de serre. Le bois est une énergie
renouvelable et contrairement à l’idée reçue, elle ne
contribue pas à la
déforestation.

Document
19 :Combustion de
bois
Il existe plusieurs formes de
combustibles :
Les bûches sont le combustible
le plus utilisé surtout par les particuliers. On peut aussi
retrouver du côté des sous-produits de l’industrie du
bois, les écorces utilisées dans les grandes chaufferies pour
nécessairement alimenter les réseaux de chaleur ou en
auto-consommation pour les scieries. Les sciures étant elles
aussi valorisées énergiquement sur place ou compressées sous la
forme de granulés pour les poêles. Le bois de rebut est broyé,
déferraillé puis criblé avant d’alimenter les grosses
chaudières. La paille et les résidus de récolte peuvent eux
aussi être présentés sous forme de granulés. De manière
générale, il faut utiliser un bois de qualité pour obtenir la
meilleure combustion qui soit. Le bois humide est donc à bannir
comme le bois traité ou vernis engendrant des émissions
toxiques. L’électricité produite à
partir du bois-énergie qui a doublé entre 1970 et 1995, connaît
depuis cette date une
quasi-stagnation.
B/ Les biocarburants
Les biocarburants peuvent
parfois être appelés agrocarburants ; ils sont issus de la
biomasse. Il existe en France deux filières de production de
biocarburants :
L’éthanol, premier carburant
d’origine végétale a être utilisé. En France il est
produit à 70 % à partir de la betterave, et à 30 % des
céréales. On peut aussi l’utiliser en le mélangeant
directement avec
l’essence.
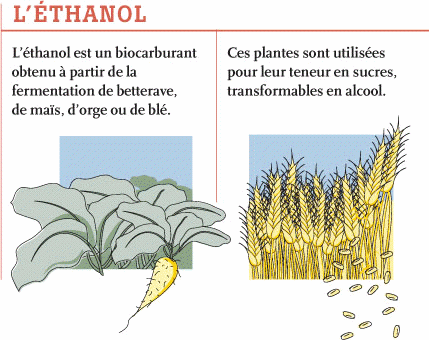
Le
biodiesel, connu plus particulièrement
sous la marque Diester, en France, il est issu de graines
oléagineuses (huiles végétales issues du colza ou du
tournesol). L’huile est mélangée avec du méthanol, pour
lui donner des propriétés proches du gazole, après pressage et
raffinage.
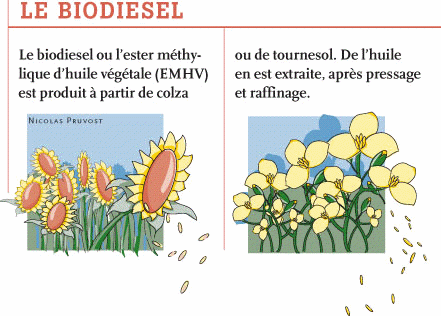
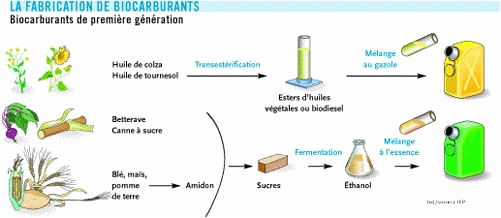
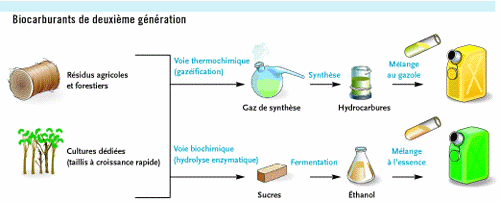
Document
21 :Les différentes étapes de la
fabrication de
biocarburants.
L’objectif des
biocarburants n’est pas de se substituer aux carburants
d’origine fossile, mais de contribuer à la recherche de
solutions alternatives. Deux pays
se sont principalement engagés dans la production de
bioéthanol, l’Allemagne et les Etats Unis. Quant à elle,
la France autorise sa fabrication depuis 1987. La production mondiale
d’éthanol, en 2005, s’élevait à 27 millions de
tonnes réparties entre plusieurs pays (Brésil et Etats Unis,
Chine, Inde, Russie, Europe…) Il faut savoir que
l’Espagne et l’Allemagne sont les deux plus grands
producteurs européens suivis de la
France. En 2006, la France a
produit 650 000 tonnes de biodiesel, principalement tirées du
colza. Diester Industrie est le premier producteur français et
européen. La production d’éthanol atteint les 234 000
tonnes produites par une vingtaine d’unités. Les biocarburants contiennent
de l’oxygène, qui assure une meilleure combustion et
diminue le rejet d’hydrocarbures
imbrûlés.
C/ Les pompes à chaleur
Les
pompes à chaleur sont des appareils capables de capter
l’énergie thermique disponible dans un environnement
extérieur (chaleur du sol ou nappes d’eau souterraines)
pour la restituer sous forme de chaleur à l’intérieur
d’un bâtiment. Elles permettent d’élever la
température d’un fluide par l’intermédiaire
d’un compresseur. Les pompes à chaleur dites réversibles,
apparues sur le marché depuis quelques années, permettent une
double restitution, de chaleur en hiver et de froid en été.
Le
marché est relancé depuis 1997 par EDF avec le lancement
d’un programme de développement des pompes à chaleur dans
le cadre de son offre commerciale « Vivrélec ». Cette offre et
la mise sur le marché des pompes à chaleur réversibles ont
contribué fortement à diffuser cette technologie qui connaît
depuis cinq ans un essor important, notamment dans les
constructions tertiaires et résidentielles
neuves.
D/ La géothermie
On appelle géothermie,
l’exploitation de la chaleur stockée dans le sous-sol.
L’utilisation des ressources géothermales se décompose en
deux grandes familles : la production d’électricité et la
production de chaleur. La température est le principal critère
pour bien cerner la filière.
La géothermie peut enfin être
qualifiée de « haute température » (plus de 150°C), « moyenne
énergie » (90 à 150°C), « basse énergie » (30 à 90°C) et « très
basse énergie » (moins de 30°C).

Document
23 :Installation géothermique
La géothermie très basse
énergie : elle s’applique
aux nappes d’une profondeur inférieure à 100m et à
faible niveau de température (moins de 30°C). La chaleur
qui est extraite de cette source est principalement
utilisée pour assurer le chauffage et le rafraichissement
des locaux.
La géothermie basse
énergie : peut être aussi appelée
basse température ou basse enthalpie, elle explore des
aquifères situés entre 1500 et 2500 m, la température
atteignant 30 à 90°C. Elle est trop faible pour produire de
l’énergie mais idéale pour produire la
chaleur.
La géothermie moyenne
énergie : peut être aussi appelée
moyenne enthalpie, elle explore le plus souvent des
gisements d’eau chaude ou de vapeur humide compris
entre 90 et 150°C. Mais pour obtenir ces températures, il
faut aller dans les bassins sédimentaires à des profondeurs
de 2000 à 4000m. Cette voie est utilisée pour produire de
la chaleur et éventuellement de
l’électricité.
La géothermie haute
température : peut être aussi appelée
haute enthalpie, elle exploite des fluides atteignant des
températures supérieures à 150°C, elle produit de
l’électricité. Entre 1 500 et 3 000m, des réservoirs
sont localisés, généralement des zones de
volcanisme.
La géothermie profonde
assistée : c’est une voie de
recherche consistant à extraire la chaleur des roches
chaudes fissurées situées entre 3 et 5 km de profondeur.
Contrairement à la géothermie haute température classique,
elle stimule les roches peu perméables en injectant de
l’eau sous forte
pression.
A ses
débuts la géothermie a dû faire face à des difficultés
techniques, notamment avec les conséquences de la corrosion,
puis à des problèmes économiques qui ont entraîné la fermeture
de certaines installations. A partir de 1998 la production
s’est stabilisée avec une moyenne annuelle de
l’ordre de 130 ktep.
E/ Le solaire thermique
Le solaire thermique signifie qu’une forte
concentration des rayons solaires, permet d’obtenir de
très haute température. Mais généralement la chaleur produite
est entre 400°C et 1 000°C.
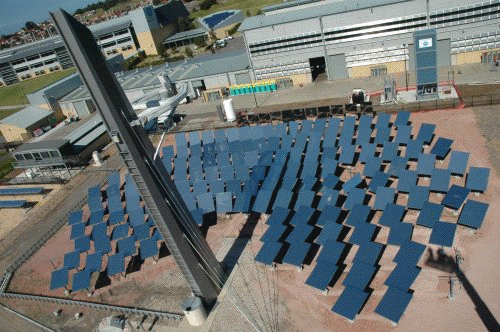
Document
25 :Installation et usine
géothermique
On peut distinguer deux usages
principaux, la production de chaleur et d’électricité.
Attention, les systèmes solaires à concentration collectent
uniquement le rayonnement solaire direct, alors que les
capteurs solaires non concentrateurs et les modules
photovoltaïques captent également le rayonnement
diffus.
Il faut savoir que dans les
centrales solaires à concentration, le solaire thermique haute
température permet de produire de grandes quantités
d’électricité. Aujourd’hui, cette filière intéresse
fortement les industriels, les investisseurs et les compagnies
électriques, car elle participe à la lutte contre l’effet
de serre ; les fours solaires à concentration, eux, sont
destinés à la recherche. Ils produisent que de la chaleur haute
température.
3) Les avantages et les inconvénients des
énergies renouvelables
A/ La petite hydraulique
La petite hydraulique possède
un avantage étant donné que c’est une énergie
décentralisée. Elle peut donc apporter de l’électricité
dans des endroits plus isolés, en retrait, elle peut aussi
maintenir ou créer une activité économique dans une zone rurale
(emplois, taxes, redevances, tourisme, etc. …). Les
petites centrales hydrauliques protègent la nature
puisqu’elles ne rejettent aucun déchet dans l’eau
et qu’elles n’émettent aucun gaz polluant.
Par exemple, on estime
qu’une centrale de 1 MW évite environ, par an,
l’émission de 2500 tonnes de CO² en comparaison
d’une centrale à combustion
classique.
De nos jours, toutes les
petites centrales sont conçues ou rénovées de manière à ce
qu’elles respectent la vie des cours d’eau et de
nombreux bâtiments ; la plupart ont fait l’objet de
divers travaux d’insertion dans le paysage.
La petite hydraulique est le
plus souvent construite au fil de l’eau, ce qui entraîne
ni vidange, ni retenue ponctuelle susceptibles de perturber la
biologie, la qualité de l’eau ou bien la tranquillité des
promeneurs… Cette réglementation très
stricte freine encore le développement des petites centrales
hydrauliques (le coût de raccordement au réseau ou celui de
l’énergie produite ou encore toutes les questions
environnementales …). Mais la filière devrait connaître
un nouveau développement en ayant de meilleurs renseignements
sur les démarches et les aides.
Il faut
savoir que la construction d’un barrage hydraulique peut
entraîner de lourdes et graves conséquences comme
l’inondation de vallées entières … Par exemple
pour les fleuves du nord-ouest d’Amérique du Nord, les
barrages hydrauliques font obstacle à la migration des
poissons, les populations de saumons ont été considérablement
réduites.
B/ L'éolienne
L’éolienne possède un
avantage important étant donné qu’il est difficile de
trouver plus « écologique ». Pendant le fonctionnement
d’une éolienne, il n’y a aucune émission de gaz
quelconque, ni de particules, il n’y a pas de rejet de
déchets, ni d’affluents, et bien-sûr aucune conséquence
sur la qualité de l’air.
Il faut savoir qu’une
éolienne peut être retirée, démontée facilement et discrètement
lorsque celle-ci présente des signes de vieillesse ou autre
… Lorsque celle-ci est démontée soit pour être remplacée
ou installée autre part, la remise en forme du sol se fait sans
souci étant donné la faible emprise au sol. L’éolienne
peut présenter un bilan écologique plutôt positif comparé à
d’autres installations pouvant impliquer de longues et
coûteuses opérations lors de leur démantèlement.
Beaucoup pensent et accusent
les éoliennes d’être un danger pour les oiseaux ; des
cadavres de chauves-souris sont régulièrement retrouvés sur les
sites éoliens, mais peu d’espèces protégées. Mais le taux
de collision est relativement faible.
En respectant certaines règles
les oiseaux et les éoliennes peuvent cohabiter, par exemple en
évitant les sites sur des trajectoires migratoires, à proximité
des zones d’espèces rares ou menacées, en rendant les
machines bien visibles
…Elles peuvent avoir un impact
sur leur intégration dans le paysage, elles détruisent le
paysage, les champs d’éoliennes sont peu
esthétique.En France, l’éolien est
un secteur en rapide croissance et il est indispensable pour
permettre à la France d’atteindre son
objectif.
C/ Le solaire thermique et photovaltaïque
Le solaire photovoltaïque est
encore bien trop coûteux pour participer significativement à la
croissance d’énergie « écologique ».
Le solaire thermique est une
filière dont le prix doit certainement diminuer grâce à
l’amélioration de la performance écologique des systèmes
et la réduction du prix des capteurs.
Le
solaire thermique est principalement sous domination chinoise,
et allemande sur le marché européen, tandis que la France
n’est que sixième sur ce marché. L’énergie solaire
et ses dérivés ne sont pas disponibles à la
demande.
D/ La biomasse ou le bois-énergie
La biomasse est nécessaire
principalement à la production de chaleur pour le chauffage, la
production de vapeur pour des procédés industriels comme le
séchage …
La biomasse consomme une très
grande quantité de dioxyde de carbone, ensuite libérée puis de
nouveau absorbée par la biomasse. Ce qui constitue donc un
équilibre, et entrainent donc un impact neutre sur
l’effet de serre, contrairement aux énergies fossiles
libérant une grande quantité de CO².
On s’aperçoit que le coût en
moyenne du combustible bois est deux à trois fois moins cher
que le gaz ou le fioul mais cette comparaison est difficile à
établir. Par contre, il génère des emplois locaux, par exemple,
l’alimentation d’une chaufferie de 1000 logements
demande quatre emplois à plein temps.
La biomasse pourrait couvrir
jusqu’à 16% des besoins français de chaleur et
d’électricité. A l’avenir, le potentiel de
ressource de la biomasse est
valorisable. Le bois est bel et
bien une énergie renouvelable. Comparé aux énergies fossiles,
le bois est de loin l’énergie ayant la durée de
reconstitution la plus rapide ; de 15 à 200 ans contre 250 à
300 millions d’années pour le charbon, et de 100 à 450
millions d’années pour le pétrole. Mais les frais
d’exploitation, et les coûts d’équipement sont
encore relativement élevés.
Ce qui
est important à savoir, c’est que le bois énergie est
l’une des filières dans l’avenir la plus
prometteuse en matière de production de chaleur. En France,
cette utilisation participe à l’entretien de la
forêt.
E/ Les biocarburants
Les biocarburants ne diminuent
pas significativement les pollutions locales. Mais c’est
un secteur qui cherche à diminuer ses rejets par tous les
moyens bien que ce soit une énergie renouvelable.
 Partie 3 : Et dans l'avenir ... Partie 3 : Et dans l'avenir ...
1) Les enjeux
A/ Les enjeux environnementaux
Depuis 1750, la concentration en
CO² dans l’atmosphère a crû de 30%, entraînant une
augmentation de la température mondiale de 0,6 degrés Celsius
de l’atmosphère et des océans lors du dernier siècle,
tandis que la température française a augmenté de près
d’un degré sur cette même période. Ainsi,
l’accroissement constant de la masse de CO², rejetée dans
l’atmosphère, a fait de l’année 2008-2009,
l’année la plus chaude enregistrée depuis cent cinquante
ans. Cette production de GES, toujours croissante, malgré des
efforts de restriction faits par les pays développés, notamment
avec le développement de pays émergents comme la Chine et
l’Inde, dont le premier est aujourd’hui le plus
grand pollueur mondial, amène la planète vers une augmentation
de la température mondiale de plus de 2% aux horizons 2100, les
experts prévoyant des augmentations de 0,2% par décennie, tout
en tenant compte des efforts de plus en plus contraignants
consentis par les Etats pour limiter leurs productions.
On peut constater sur ce
schéma, l’élévation continue de la température depuis un
siècle et demi, particulièrement depuis les années 1980 en
concordance avec les augmentations importantes de
l’activité carbonique mondiale à cette
période.
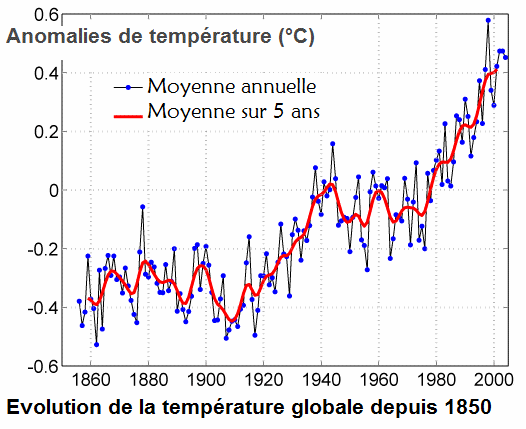
Document
26 :Evolution de la température
globale depuis 1850
Ce réchauffement, outre son
effet en lui-même, s’il a déjà commencé à provoquer des
réactions importantes sur l’environnement, est surtout
inquiétant pour ses effets futurs sur des éléments dont
l’homme s’est désintéressé mais qui
aujourd’hui sont les principales sources
d’inquiétudes.
Ainsi, l’augmentation de
la température mondiale est en passe de faire disparaître la
glace de l’Arctique d’ici 2050, si l’on en
croit les experts, le volume annuel moyen des glaces reculant
déjà de 2 à 3 % par décennie dans cette région du globe depuis
de nombreuses années. La calotte groenlandaise a ainsi perdu 1
500 milliards de tonnes de glace entre l’an 2000 et 2008,
l’Antarctique s’en sortant pour l’instant
mieux grâce à ses températures plus froides, mais elle
commence, elle aussi, à fondre sur une partie de sa calotte,
sur les côtes et sur sa
péninsule.
Si la perte de la glace
n’est pas un problème en soi dont l’on pourrait
s’inquiéter, ses conséquences en sont un. En effet, la
fonte des pergélisols, sols et sous-sols gelés en permanence,
provoquerait la libération notamment de méthane, gaz dont
l’effet vingt et une fois supérieur à celui du CO²
alimenterait un cercle vicieux, ces gaz provoquant eux même une
accélération du réchauffement faisant à nouveau fondre les
pergélisols restants et ainsi de suite. On peut d’autant
plus craindre cela quand on sait que ces pergélisols renferment
actuellement l’équivalent de deux fois la quantité de
carbone contenue dans
l’atmosphère.
La
crainte la plus grande néanmoins, est l’élévation des
niveaux de la mer, principale conséquence de la fonte des
glaciers, ce qui d’après plusieurs rapports
d’experts, conduirait à l’inondation de nombreuses
régions aussi bien dans le Sud de l’Inde, qu’aux
Etats-Unis à Miami, ou qu’en France dans le Languedoc
Roussillon par exemple ainsi que de nombreuses îles et
archipels comme les Maldives d’ores et déjà condamnées à
disparaître dans un avenir qui se mesure certainement en
décennies et dont les migrants poseront un problème de plus à
gérer.
Ce
problème risque d’être d’autant plus réel dans
l’avenir quand on sait que 160 millions de personnes
vivent à moins d’un mètre d’altitude au dessus de
la mer et que la seule fonte de la calotte glacière
groenlandaise suffirait à élever le niveau des mers de plus de
6 mètres, et de 53 mètres environ en cas d’une fonte
complète de l’Antarctique. Si une fonte complète de
l’Antarctique est pour l’instant exclue, du fait de
sa relative résistance, celle de l’Arctique est elle bien
amorcée, entrainant avec elle l’extinction
d’espèces telle que les ours
blancs.
B/ Les enjeux humains et animaliers
Les bouleversements causés par les gaz à effets de serre sur
la faune et la flore ne se limitent pas pour autant aux seuls
ours polaires ; ainsi depuis plusieurs décennies
s’instaurent des dérèglements de la nature sur les
périodes migratoires des oiseaux, de récoltes de blé ou de la
vigne et dont la qualité s’amenuise par les changements
des conditions climatiques en France.
De plus, le nombre de feux de forêt chaque année devrait
continuer à croître avec l’accroissement de la
température causant toujours plus de dégâts, principalement
matériels et économiques mais aussi humains par la dangerosité
de leurs effets. On peut aussi penser aux possibles baisses de
certaines productions agricoles principalement dans des pays en
développement à cause du réchauffement global de la
température. Les espèces animales et végétales, elles, sont
menacées d’extinction pour 20 à 30 % d’entre elles
en cas d’élévation de la température au-delà de deux
degrés, fragilisant et bouleversant alors l’écosystème si
cela venait à se produire.
Nos émissions de
gaz à effets de serre, désormais en quantités trop grandes pour
être absorbées totalement par les océans et les végétaux comme
ce put être le cas jusqu’au début du XXème siècle, ont
donc nombre de conséquences qui atteignent aussi bien les
hommes, que la faune, la flore, et l’environnement en
lui-même avec certaines parties du globe noyées sous
l’eau et les extinctions d’espèces, qui risquent de
devenir de plus en plus fréquentes au cours des décennies et
siècles à venir.
C/ Les enjeux économiques
Si les conséquences sur la vie humaine n’ont pas de
prix, celles sur les infrastructures et sur nos économies
risquent de se chiffrer en dizaines de milliers de milliards de
dollars, soit plusieurs dizaines de fois le PIB de la France.
Face à cette réalité humaine et économique, conjuguée à
l’épuisement inéluctable de nos ressources énergétiques
principales et également les plus polluantes que sont le
charbon, mais surtout le pétrole, ainsi même que le nucléaire
bien que très peu polluant par rapport aux deux autres, Etats,
entreprises et associations ont compris que le salut de la
France, et du monde d’une façon plus générale, ne
passerait que par un profond changement et remaniement de nos
sources d’énergies et de nos industries et technologies,
mais aussi des mentalités qui, habituées à un gaspillage
énergétique exempt d’inquiétude pour ses conséquences au
cours du siècle précédent, restent lentes à changer .
2) Les actions
A/ Les accords européens, mondiaux et les
objectifs
Le protocole de Kyoto ratifié en
1997 par nombre de pays, marqua le début d’une ère
nouvelle dans la lutte pour la préservation de
l’environnement et contre le réchauffement climatique
avec les premiers accords réellement contraignants où la France
prit un engagement de réduire de 8 % ses émissions de gaz à
effets de serre d’ici 2012 par rapport à ses émissions de
1990. Cet accord, signé par la majorité des pays du monde, a
instauré des réductions d’émissions de GES pour les pays
développés, notamment pour l’UE, qui est désignée aussi
bien dans le protocole de Kyoto que dans L’UNFCCC,
l’accord antérieur au protocole de Kyoto, comme
l’un des principaux responsables du réchauffement
climatique.
Les pays en voie de
développement sont donc logiquement soumis à des restrictions
beaucoup moins importantes du fait de leurs responsabilités
moindres et du besoin de développement nécessaire qu’ils
revendiquent et qui passe par une augmentation régulière de
leurs besoins en énergie que les avancées dans les énergies
renouvelables ne peuvent encore couvrir.
B/ Les actions concrètes
La France, comme beaucoup
d’autres pays développés, s’est, elle, fixée un
certain nombre d’objectifs en plus de ses promesses de
réduction de GES pour 2012, en passe d’ailleurs
d’être tenues puisqu’elle a à ce jour réduit de
5,6% ses émissions sachant qu’il reste trois ans pour
atteindre l’objectif fixé de 8%. Des accords européens
prévoient ainsi une part minimum obligatoire des énergies
renouvelables dans la consommation d’énergie visant les
21 % de consommation d’électricité produits par les
énergies renouvelables ainsi que 12% pour la consommation
d’énergie primaire.
Toutes ces contraintes désormais
en place, la France s’est vue obligée d’investir
dans les constructions éoliennes qui chaque année connaissent
une augmentation de plus de 100%, et dont l’Etat prévoit
de multiplier leur potentiel de production par dix d’ici
2020, ainsi que dans les centrales hydrauliques qui au nombre
de plusieurs centaines produisent désormais 8% de
l’électricité produite en France.
Le développement récent de
nouvelles énergies comme le solaire photovoltaïque, la
géothermie ou le bois énergie ou encore celle de la biomasse
devrait prendre une part de plus en plus importante dans les
années à venir dans la consommation d’énergie française.
Le secteur privé notamment dans
l’automobile s’adapte lui aussi à cette révolution
verte qui se produit en France et voitures électriques et
biocarburants sont appelés eux aussi à prendre une place
croissante dans l’industrie automobile avec
l’objectif de remplacer les voitures trop polluantes, et
dépendantes du pétrole vouées à disparaître de toutes les
façons.
On voit ici sur ce schéma les
principales voies de l’avenir en ce qui concerne les
énergies renouvelables :
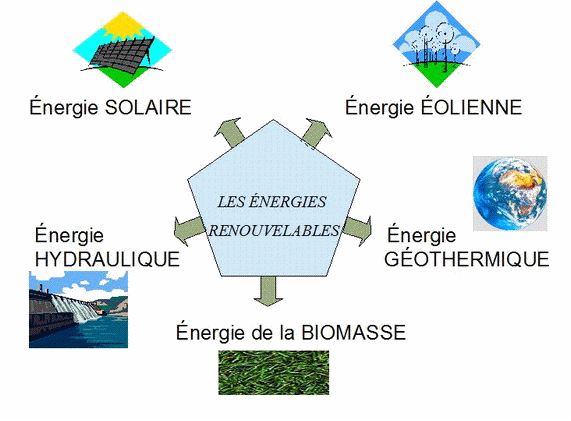
Document
27 :Les différentes énergies
renouvelables
Les énergies renouvelables sont
aujourd’hui réellement rentrées dans la vie courante et
la mise en place de mesures citoyennes comme les vélibs à Paris
et d’aides nombreuses comme le crédit d’impôt pour
l’installation de panneaux solaires ou de système
géothermique chez soi, qui combinés aux aides municipales et
régionales peuvent couvrir jusqu’à 85 % du montant de
l’installation, tendent à faire changer les manières et
comportements des citoyens.
C/ Les actions futures
La création du Grenelle de
l’environnement en 2007, rassemblement politique sur la
question écologique et les solutions à prendre, a également
marqué un tournant décisif dans le projet écologique français,
qui dispose désormais du Grenelle comme moteur d’idée de
projet et d’ambition ainsi que de son propre ministre de
l’écologie M. Jean-Louis Borloo.
Toutes ces créations sont le
symbole de la prise de conscience politique sur le sujet
écologique et en particulier sur les énergies renouvelables, et
marquent le passage de l’abstrait des discours sur le
sujet sans réelle action à un réel projet de développement pour
les énergies renouvelables en France, de toute façon devenu
nécessaire au vu du contexte et des changements climatiques qui
se font déjà sentir mais dont les principaux maux sont encore à
attendre. La possible mise en place d’une taxe carbone en
France avec une tonne de carbone fixée à 14 euro, est un signe
de l’importance que jouent désormais le climat et les
énergies renouvelables dans le paysage social, politique et
humain français.
Le sommet de Copenhague,
organisé en décembre 2009 et rassemblant la plupart des chefs
d’Etat, Chine et Etats-Unis inclus, aura pour mission
d’assurer la continuité du protocole de Kyoto en créant
de nouveaux accords internationaux qui aboutiront peut-être à
une réduction de 30% des émissions de GES à l’aube de
2020 pour la France et l’Union Européenne, qui se sont
pour l’instant déjà engagées sur un chiffre de 20 % et
ont déjà accompli la moitié de cet objectif grâce à une
réduction jusqu’à aujourd’hui de 10,6 % .
C’est une semaine de
négociation entre tous les chefs d’Etat qui
s’annonce, semaine pendant laquelle, en fonction de ce
qui aura été signé, se décideront les nouvelles lignes
directrices à adopter pour chacun dans la lutte contre le
réchauffement climatique, du développement des ressources
renouvelables et de l’aide aux pays en voie de
développement pour supporter le poids de ces changements. Quoi
qu’il soit décidé lors de ce sommet copenhagois,
c’est toute la politique mondiale, européenne et
française en matière de développement durable qui se formera
pour les années à venir à son issue et qui décidera de
l’avenir de notre planète.
La France, d’abord en
retard sur certains plans du développement des énergies
renouvelables car peu sensibilisée et toujours réticente à
laisser le nucléaire de côté au profit d’énergies
renouvelables, s’y met au fur et à mesure prenant une
part dans la production européenne des énergies renouvelables
de plus en plus grande comme nous le montre ce
graphique :
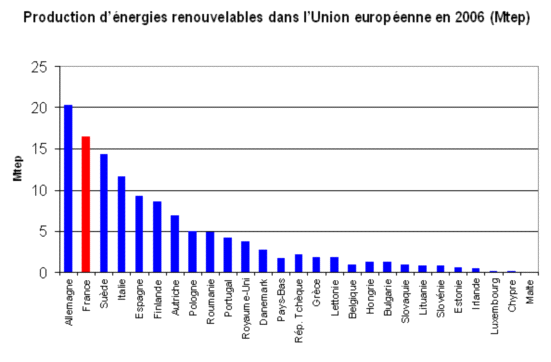
Document
28 :La production d’énergies
renouvelables dans l’Union Européenne en
2006
On voit
donc une nette croissance du développement des énergies
renouvelables en France due à une prise de conscience politique
ayant amené les mesures nécessaires à son développement, ainsi
qu’à la nécessité de trouver des alternatives
énergétiques, que la durée de vie limitée du pétrole et les
troubles qu’il occasionna lorsqu’il dépassa les 120
dollars du baril nous rappela.
3) Les limites
A/ Les limites techniques et économiques
Malgré les volontés affichées,
les discours prononcés et les mesures décrétées, force est de
constater que cela n’est tout simplement pas suffisant.
Certes, la prise de conscience politique a bien eu lieu et les
pays partout dans le monde se sont tous, ou presque, accordés à
dire que des efforts devaient être faits et tous ou presque en
ont faits. En France, depuis le célèbre discours de Jacques
Chirac du 2 septembre 2002 à Johannesburg à l’occasion du
troisième Sommet de la Terre qui clama que l’ « on
regardait dans la mauvaise direction pendant que la maison
brûlait » , la diffusion de films comme celui d’Al Gore
sur l’alarmant constat climatique, les nombreux rapports
d’experts et la montée en puissance de partis politiques
à portée écologique comme Les Verts ou bien récemment Europe
écologie, qui montrent bien l’intérêt croissant des
Français pour la cause écologique, de vraies actions ont été
mises en œuvre par le gouvernement telles que le
développement accéléré des énergies renouvelables, des
sensibilisations citoyennes, des aides aux installations
personnelles de matériel produisant peu ou pas de GES et des
objectifs officiels adoptés souvent dans un cadre mondial, ou
européen.
Toutefois, même si l’Etat
français et les pays européens semblent s’investir, cela
reste toutefois limité avec à peine 20 milliards d’euros
investis en France en 2008, à hauteur d’1% du PIB
seulement ce qui est très loin des centaines de milliards
d’euro qu’évoque la BCE, Banque Centrale
Européenne, pour apporter une solution efficace au problème.
Malgré tout, même si les
montants restent relativement faibles compte tenu du fait de
l’importance du problème, les difficultés pour réussir à
remplacer et à substituer toutes nos productions énergétiques
par des énergies renouvelables demeurent car malgré les plans
de développement de panneaux solaires, et les éoliennes
construites en nombres toujours plus grands, leurs parts dans
la production d’énergie restent mineures. De même le
stagnation de l’exploitation de l’électricité
hydraulique, les capacités supplémentaires de cette énergie à
exploiter en France étant faibles du fait d’une
exploitation quasi maximum alors que l’hydroélectricité
ne parvient même pas atteindre les 10 % de la production
globale d’électricité du pays empêchera sans doute la
France d’atteindre son objectif européen de 21 %
d’électricité renouvelable en 2010 n’étant
qu’à 14 % fin 2009.
Pour ce
qui est des objectifs d’ailleurs, les scientifiques
chiffrent à un minimum de 40% de réduction des émissions de CO²
en 2020 pour éviter le franchissement du palier de 2 degrés de
plus en 2100, alors que l’UE ne s’est engagée
qu’à une réduction de 20% seulement de ses gaz à effets
de serre d’ici 2020.
B/ Les limites diplomatiques
Ce n’est toutefois pas le
principal problème rencontré jusqu’ici. En effet si
l’UE et la France ont pris plusieurs mesures
énergétiques, les plus gros pollueurs mondiaux se sont pour
l’instant exemptés de toute implication dans la lutte
contre le réchauffement climatique qu’ils provoquent
eux-mêmes. Ainsi les Etats-Unis, plus grand pollueur mondial
jusqu’en 2007, a toujours refusé de prendre des mesures
contraignantes pour les énergies renouvelables et la lutte
climatique, l’administration Bush par exemple niant
presque l’existence même du phénomène du réchauffement
climatique et donc de l’intérêt du développement durable,
de même pour la Chine et d’autres pays en voie de
développement comme l’Inde, qui refusent de se soumettre
à des restrictions fermes sur leurs utilisations des énergies
fossiles et polluantes, et donc leurs productions de GES dans
l’atmosphère.
Américains et Chinois, qui
représentent à eux seuls quasiment la moitié des émissions de
GES restent donc parmi les moins investis face au problème et
les solutions que proposent ces premiers sont pour
l’instant faibles avec 20 % de réduction des GES pour les
Etats-Unis en 2020, mais en prenant l’année 2005 pour
base et non l’année 1990 comme les autres pays ce qui ne
fait donc en fait que 4% de réduction par rapport à 1990 pour
les Etats-Unis, et un refus de toute restriction pour les
Chinois alors qu’ils sont devenus depuis l’année
dernière les plus grands pollueurs mondiaux devant les
Etats-Unis et se contentent de proposer une simple réduction de
leurs intensités carboniques de 40% pour 2020 ce qui correspond
en fait à une augmentation de 10% de leurs émissions de gaz à
effets de serre.
Comme on peut le voir sur ces
différents schémas, les plus grands pollueurs sont les
Etats-Unis et la Chine, et les plus grands foyers de peuplement
mondiaux en développement comme le Brésil, la Russie,
l’Inde et la Chine appelés la BRIC.
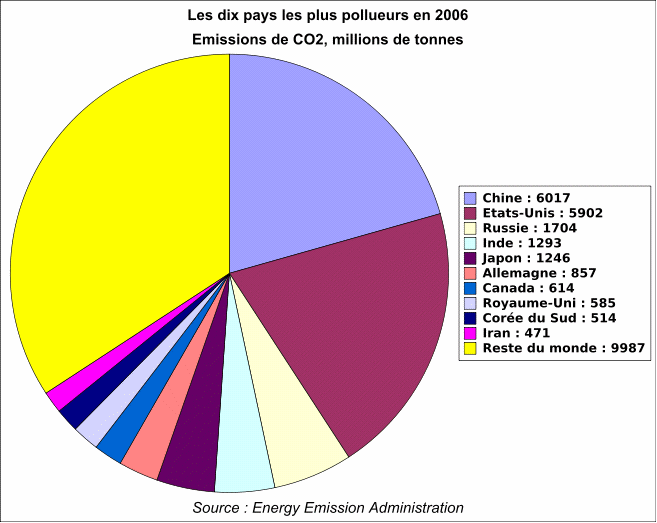
Document 29 :Les dix pays les plus pollueurs
en 2006
On voit
également le peu d’installations pour les énergies
renouvelables dont ils disposent, hormis un effort récent de la
Chine, dû principalement à leur refus d’adhérer à des
mesures contraignantes comme l’ont fait l’Europe et
la France et aux besoins importants de développement rapide par
le biais des énergies fossiles dont dépend encore la BRIC.

Document 30 :La capacité totale installée
des énergies renouvelables des cinq premiers pays (en millions
de Kilowatts)
On peut donc constater une
répartition inégale du poids de la lutte environnementale et
climatique dont certains des principaux responsables comme les
Etats-Unis continuent de polluer plus sans se sentir coupables
quand de petits pays, tel la Lituanie ou la Lettonie, faibles
pollueurs et faibles financièrement, doivent s’imposer de
nouvelles restrictions pour tenter de compenser ce qu’ont
causé les premiers.
De plus, hormis la volonté
politique et populaire qui varie d’un pays à
l’autre, le défi technique et financier reste un frein
pour bon nombre de pays même en Europe où l’on hésite à
accorder les budgets que les rapports d’experts estiment
nécessaires.
C’est
autant de difficultés ajoutées à la tâche ardue de trouver des
accords justes et équitables qui puissent satisfaire tout le
monde sur le sujet, ce qui ralentit l’expansion du
développement durable dans le monde.
4) Les opinions
A/ L'opinion public
Si le développement durable est
aujourd’hui bien perçu par une majorité de la population,
désormais intégré comme inhérent et nécessaire à la société et
à l’avenir, cela n’a pas toujours été le cas.
Ainsi, pendant longtemps, le développement durable,
jusqu’à la prise au sérieux du réchauffement planétaire
et des futurs problèmes engendrés par l’utilisation de
toutes les réserves de nos énergies fossiles, est d’abord
réfuté, tout comme le réchauffement climatique et le futur
manque de pétrole que personne ne veut entendre quand
l’économie se développe et que ces énergies rendent
certains pays riches grâce à leurs ressources et que
d’autres se développent grâce à leurs utilisations.
B/ L'opinion des institutions
Toutefois, les différents chocs
pétroliers font prendre conscience des problèmes de manque qui
vont survenir, et les rapports de la communauté scientifique et
notamment du GIEC, au sujet du réchauffement climatique imputé
aux rejets de gaz carbonique dans l’atmosphère font eux
prendre conscience des dangers que la planète court du fait des
effets néfastes de nos activités énergétiques.
Tout cela engendra, rapport
après rapport, de plus en plus alarmants, sur le climat et sur
les conséquences à venir pour la faune, la flore,
l’économie, l’Homme et l’environnement et des
prix du pétrole toujours plus hauts, avec des ressources
futures réduites encore par l’émergence
d’industries de pays en voie de développement, une vraie
prise de conscience politique et populaire quant à la nécessité
du développement durable aussi bien pour la planète que pour
nos énergies.
Les conventions et traités de
Kyoto ont amorcé les premières mesures réelles dans
l’abandon progressif des énergies polluantes et fossiles
pour des énergies propres et
renouvelables.
Toutefois
le consensus n’est pas globale, la gravité de la
situation n’empêcha pas certaines polémiques de
subsister, comme celles qui mettent aux prises certains
chercheurs, remettant en cause l’influence du CO² sur la
température mondiale dans l’atmosphère et donc
l’intérêt par là-même du développement durable avant tout
épuisement des ressources
fossiles.
C/ L'opinion des ONG
On peut aussi voir que si
certaines associations, et ONG, paraissent satisfaites du
chemin pris par la France dans l’accroissement des
efforts dans le développement durable comme la fondation de
Nicolas Hulot, certaines comme Green Peace ou comme certains
chercheurs semblent eux critiquer l’inefficience des
engagements pris et le manque de moyens financiers accordés au
développement durable.
 Conclusion Conclusion
Le premier choc pétrolier de
1973 fut l’amorce d’une diversification des
énergies. Il résonna en effet comme le son de cloche de
l’alerte énergétique, où pour la première fois, les pays
consommateurs commencèrent à prendre conscience de la réalité,
présente et future. Ils réalisèrent par la force des choses, la
dépendance pétrolière à laquelle ils étaient soumis, et qui les
rendait impuissants face à l’OPEP, pays exportateurs de
pétrole, qui comme ils l’ont montrés en 1973 pouvaient
d’un coup créer une panique énergétique en augmentant
brutalement les prix, au point de pousser la France à la
construction effrénée de centrales nucléaires.
Le deuxième choc de 1979 vint
accélérer le processus de diversification énergétique, après
une envolée du cours du baril sans précédent. Ces turbulences
néfastes autour du pétrole que les économies des pays
consommateurs subirent de plein fouet se conjuguèrent avec
l’accroissement du nombre de rapports scientifiques qui
mettaient en exergue non pas les conséquences néfastes de la
dépendance pétrolière sur l’économie mais celles sur
l’environnement, bien plus
inquiétantes.
La montée de la cause
écologique et de la crédibilité d’un réchauffement
climatique incombé aux GES que produisent la combustion
d’énergies fossiles tel que le pétrole, pointé du doigt
par les experts finira par déboucher sur plusieurs Sommets de
la Terre, rencontres de chefs d’états pour statuer sur ce
problème.
Le premier en date fut celui de
Stockholm en 1972, mais il fallut attendre 1992 et celui de Rio
pour obtenir un consensus mondial réunissant plus de cent pays
et définissant clairement des objectifs de réductions de GES et
des moyens de mise en œuvre pour les atteindre. A compter
de cette date, le sujet prit toute l’importance
qu’il méritait, comme en démontre le traité de Kyoto,
accord environnemental signé par une majorité des pays du
globe, la multiplication des ONG défendant la cause écologique
et l’importance croissante prise au niveau politique,
avec la création d’un ministère de l’écologie en
France. Les actions mises en œuvre, désormais
obligatoires pour respecter les mesures auxquelles le
gouvernement français s’est contraint que ce soit dans
plusieurs traités européens ou mondiaux passent par une
sensibilisation citoyenne, et un développement des énergies
renouvelables, pour parer aux futures pénuries pétrolières et
charbonnières, et propres, pour endiguer la pollution et ses
conséquences et respecter les objectifs fixés dans ce
domaine.
La France a donc vu depuis les
années 1970 le nombre de centrales hydrauliques, et
d’éoliennes s’accroîtrent et le bois énergie, le
photovoltaïque et les biocarburants se développer. Les énergies
renouvelables représentent ainsi environ 6% de la consommation
d’énergie en France. Certaines mesures citoyennes sont
apparues dans ce sens telles que les vélibs et les futurs
autolibs, vélo mis à disposition des citoyens pour remplacer
les voitures polluantes pour les premiers et voitures
électriques non-polluantes pour les deuxièmes. L’action
étatique, composante nécessaire et essentielle au développement
durable, est aussi active par le biais d’aides au
financement de la mise en place de matériaux et
d’installations, notamment de chauffage, respectueuses de
l’environnement.
Aujourd’hui,
l’écologie, le développement durable et la croissance
verte sont connus de tous, présents dans tous les médias et
figures de proue des nouvelles accroches publicitaires,
notamment des constructeurs automobiles qui en font un argument
de vente pour leurs nouvelles voitures « vertes ». Les ONG
mobilisées depuis des années sur le sujet auront sans doute
contribué au changement des
mentalités.
Toutefois
les limites techniques imposées par les énergies renouvelables
à grande échelle, très coûteuses et moins performantes que le
pétrole, ainsi que le manque de cohésion politique mondiale sur
le sujet, avec notamment la Chine et les Etats-Unis toujours
réfractaires à des mesurent de restrictions de GES importantes
alors qu’ils sont les premiers pollueurs mondiaux restent
un souci d’envergure pour le développement durable,
nécessaire à la sauvegarde de la planète. L’échec du
sommet de Copenhague, dû aux deux pays précédemment cités sont
la preuve que malgré les bonnes volontés, les actions concrètes
et accords nécessaires à celles-ci restent encore difficiles à
mettre en place. Le temps est pourtant compté.

|













